07/07/2010
_Perry Rhodan : Lecture des textes_
Perry Rhodan : Lecture des textes : Jean-Michel ARCHAIMBAULT : 1999 : Encrage (collection "Références" #10) : ISBN-10 2-906389-92-7 : 183 pages (y compris bibliographie) : coûtait 65 FRF pour un petit TP.

Série fleuve (largement plus de 2000 fascicules pour l'intrigue principale) à la longévité exceptionnelle (elle se rapproche de son demi-siècle), la saga allemande Perry Rhodan est un des monuments de la SF. Ayant toujours eu du mal à percer en dehors de l'Europe continentale (les éditions anglo-saxonnes seront des échecs des deux côtés de l'Atlantique), elle sera surtout populaire en France et aux Pays-Bas malgré un décalage de parution important. Le but de cet ouvrage de J. M. Archaimbault (un des principaux fans français) est donc de nous faire découvrir la vraie étendue de cet univers fictif.
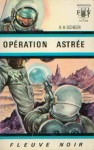
Ce livre est divisé en quatre parties principales (de taille très variable) qui succèdent à une courte introduction. La première est une chronologie de la parution de la série dans son pays d'origine avec les principaux évènements année par année. La deuxième est un "commentaire critique" qui évoque les divers éléments de l'ensemble romanesque (cadre, personnages, modèles scientifiques employés, style). Le plus gros morceau du livre est constitué par le troisième chapitre qui est un résumé de l'intrigue des 2000 (ou presque) épisodes de la saga, ventilé en cycles et sous-cycles. La dernière partie n'est constituée que de quelques pages évoquant la réception critique (généralement négative) de la série en France et aux USA. On trouve ensuite plusieurs annexes : lexique, listes des auteurs et des principaux illustrateurs, chronologie de la VF, table de correspondance des titres et bibliographie secondaire. Il n'y a pas d'index.

Clairement écrit par un passionné, cet ouvrage permet de savoir l'essentiel sur cette saga sans avoir à lire l'allemand (ni les 2500 ouvrages qui la composent) ou à collectionner les FN. La partie la plus intéressante est celle relative à la stricte aventure éditoriale de la série où l'on voit se bâtir un univers complet avec la coordination de multiples collaborateurs. Par contre, le résumé des cycles est, à mon avis, plutôt indigeste à la fois par son ampleur (cela fait quand même quelques centaines de milliers de pages à synthétiser) mais aussi par l'abus de ces termes vaguement scientifiques si typiques de la série et par la multiplication des intervenants.
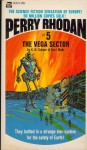
C'est donc un ouvrage qui est malgré tout à réserver à des amateurs purs et durs de Perry Rhodan qui seront plus à même de tolérer l'habituel mélange de repli défensif (justifié par les réactions critiques assez mauvaises de la part d'une partie du fandom), de manque de recul ("c'est trop génial") et de prétentions à une certaine grandeur comme le montre l'abus par Archaimbault du terme de "Hard-Science" pour cette saga qui est quand même, scientifiquement parlant, plus proche de E. E. Smith que de Forward. En tout cas un bon guide pour un authentique phénomène du genre qui aurait surtout gagné à être allegé de certaines parties (l'interminable résumé) mais aussi à être capable d'un discours critique un peu plus réaliste.
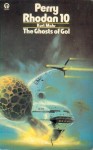
Note GHOR : 2 étoiles
07:14 | 07:14 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, perry rhodan, 2 étoiles | Tags : français, perry rhodan, 2 étoiles
06/07/2010
_Periodic stars_
Periodic stars : An overview of science fiction literature in the 1980s and '90s : Tom EASTON : Borgo Press (série "I. O. Evans Studies" #24) : 1997 : ISBN-10 0-8095-1202-5 : 264 pages (y compris index) : coûtait 27 USD à l'époque pour un TP non illustré qui existe aussi en HC (-0202-X), parfois trouvable d'occase mais assez peu fréquent comme la plupart des ouvrages de cette série.

Chronologiquement antérieur à Off the main sequence du même auteur, cet ouvrage est un recueil (partiel) des critiques d'ouvrages de SF faite par Tom Easton pour le magazine Analog entre 1980 et 1990. Pour mémoire, Easton est lui même un auteur que l'on pourrait voir comme étant estampillé Analog donc créant une SF plutôt orientée "technique" et d'idéologie libérale et dont l'oeuvre principale est la pentalogie "Organic future" (en livre chez Ace dans les années 90) dont certaines parties ont été justement publiées en serial dans ce magazine.
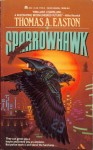
Cet ouvrage rassemble donc 250 critiques concernant seulement 72 auteurs puisque le choix de Easton pour ce volume est de se concentrer sur les auteurs les plus productifs (ceux dont il a au moins chroniqué trois titres). Après une préface et une introduction, ce recueil rassemble donc 250 notes de lectures d'à peu près une page chacune (le format habituel dans les magazines de SF). Allant de Agviq (Michael Armstrong) à The urth of the new sun (Gene Wolfe), elles sont organisées par ordre alphabétique d'auteur et chronologiquement ensuite. Après avoir donné les éléments bibliographiques de l'édition évoquée, elles suivent un même schéma avec une courte présentation de l'auteur, un résumé de l'intrigue (c'est la partie majoritaire) et un avis final. En fin d'ouvrage, deux index (par auteur et par titre) permettent de naviguer dans celui-ci.
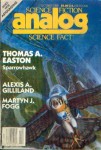
L'ensemble est plus à utiliser comme un guide de lecture que comme le témoin de l'élaboration d'une théorie de la SF (comme peuvent l'être des ouvrages sur un principe similaire par Clute ou Wolfe). Easton se concentre sur l'indication des péripéties de l'intrigue et ne pose que rarement de jugement tranchés et est globalement plutôt laudatif. C'est donc de la critique-information et non de la critique-démolition.
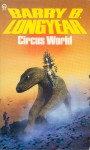
Tout cela se lit par petites doses d'une façon assez agréable et permet d'avoir un premier avis sur un livre dont on envisage l'achat, et c'est justement sûrement comme cela que Easton a conçu son travail. Un autre intérêt de ce livre, certainement non prévu, est de nous permettre de toucher du doigt les évolutions du genre et le passage des modes ou des auteurs. Il est assez étonnant de voir que par exemple, pas moins de quatre chroniques sont consacrées à Barry B. Longyear ou même cinq à Jeffrey A. Carver (ce qui indique bien leur importance à l'époque) alors que ce sont des écrivains qui sont presque complètement oubliés de nos jours. Une pensée à méditer.

Note GHOR : 2 étoiles
07:29 | 07:29 | Recueils de critiques | Recueils de critiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, easton, 2 étoiles | Tags : anglais, easton, 2 étoiles
23/06/2010
_A checklist of Astounding_
A checklist of Astounding : Part 1 : 1930 to 1939 : B. T. JEEVES : 1963 : ERG Publications : pas d'ISBN : 52 pages : pas de prix pour une publication fanzinesque non illustrée format A4 avec agrafage latéral et couverture cartonnée, introuvable sauf par accident.

A checklist of Astounding : Part 2 : 1940 to 1949 : B. T. JEEVES : 1965 : B. T. JEEVES : pas d'ISBN : 45 pages : pas de prix pour une publication fanzinesque non illustrée format A4 avec agrafage latéral et couverture cartonnée, introuvable sauf par accident.

A checklist of Astounding : Part 3 : 1950 to 1959 : B. T. JEEVES : 1970 : pas de mention d'éditeur : pas d'ISBN : 52 pages : coûtait 10 shillings pour une publication fanzinesque non illustrée format A4 avec agrafage latéral et couverture cartonnée, introuvable sauf par accident.

On a du mal à se rendre compte, depuis notre époque connectée, des problèmes que les amateurs un tant soit peu bibliographes pouvaient rencontrer avant qu'Internet et les sites bibliographiques qui y foisonnent n'existent. La solution était toujours la même, la collation "à la main" de sa propre collection et, si l'on avait suffisamment de courage, l'édition sous forme de fanzine du résultat de ses travaux. Confronté à l'absence d'index pour la revue majeure du genre (Astounding avant de devenir Analog), c'est donc à cette tâche que s'est attelé sur une période de presque dix ans le fan britannique Terry Jeeves.

Il a donc produit cet ensemble de trois index (il ne semble pas y en avoir eu de quatrième) qui couvrent chacun une décennie de la revue depuis ses débuts en 1930. Il est à noter que c'est la version US qui est traitée et non l'édition britannique qui était décalée dans le temps et aussi légèrement différente dans son contenu, un détail amusant vu la nationalité de l'auteur. Après une introduction d'une page on trouve une structure globalement semblable pour les trois volumes : un listing par numéro (qui donne le contenu de chacun), un listing par auteur qui couvre les textes de fiction et les articles mais pas les éditoriaux de Campbell ou ses prédécesseurs, la partie critiques ou le courrier des lecteurs ("Brass Tacks"), un listing par titre (idem) et un listing séparé pour les articles et les textes de la série "Probability Zero" (qui sont en fait des short-shorts). Le dernier volume inverse cet ordre pour les deux index du milieu et rajoute un index des éditoriaux et des couvertures ainsi qu'une table de correspondance de pseudonymes.
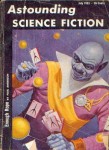
Comme d'habitude avec ce type d'ouvrage, il s'agit d'un outil extrêmement spécifique qui ne peut que servir de base de vérification auxiliaire au vu du nombre très important d'autres ouvrages papier (le Murray) ou informatiques (le Miller & Contento) voire de sites plus ou moins généralistes (ISFDB) qui proposent les mêmes données. Malgré tout, le côté historique et l'exactitude (après vérifications) de cet ensemble lui assurent d'obtenir une place dans une bibliothèque de recherche bibliographique même si l'on aurait presque préféré que Jeeves traite la version britannique du titre, un domaine assez peu exploré même de nos jours.
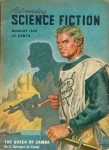
Note GHOR : 2 étoiles
07:23 | 07:23 | Index, dictionnaires & bibliographies | Index, dictionnaires & bibliographies | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles, astounding | Tags : anglais, 2 étoiles, astounding
18/06/2010
_On Philip K. Dick : 40 Articles from Science-Fiction Studies_
On Philip K. Dick : 40 Articles from Science-Fiction Studies : Divers editors : 1992 : SF-TH Inc. : ISBN-10 0-9633169-1-5 : xxx+290 pages (y compris bibliographies et index) : coûtait 17 USD pour un TP non illustré, existe aussi en HC (-0-7).

Cet ouvrage est un recueil d'essais consacrés à Philip K. Dick et parus dans le journal académique Science-Fiction Studies (co-fondé par Darko Suvin). Cette revue a toujours été un peu a part dans le petit monde des journaux d'études universitaires sur la SF (comme Extrapolation ou Foundation), à la fois par son approche critique (généralement marxiste) et par ses choix de sujets souvent consacrés à une partie assez limitée du genre caractérisée par une certaine respectabilité cosmopolite (donc, et comme d'habitude, Dick, Le Guin et Lem). Il n'est donc pas surprenant que PKD ait "fait un tabac" dans ses colonnes puisque le 5ème numéro sera déjà un "Spécial Dick" et qu'encore un autre lui sera consacré plus tard (le #45 en Juin 1988).

Comme son sous-titre l'indique, ce volume rassemble 40 textes sur PKD issus de la revue SFS. Cet ensemble d'articles, de critiques, de lettres ou de réponses à des articles précédents est divisé en quatre parties principales d'une soixantaine de pages organisées chronologiquement. La première correspond au numéro spécial qui lui a été consacré en 1975, la deuxième couvre la période 1975-1987, la troisième est constituée du SFS #45 (l'autre spécial PKD), elle est suivie de la dernière qui regroupe les articles parus dans les années 1989-1992 (c'est aussi logiquement la plus courte). Il y a pas mal d'annexes : une introduction de Csicsery-Ronay, un recensement des manuscrits de l'auteur à Fullerton, une bibliographie primaire chronologique, une bibliographie secondaire et deux index (un par titre d'oeuvre de PKD cité et un par noms propres).
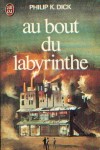
D'une façon générale, ce recueil est à réserver aux spécialistes de Dick. En effet, il réclame un bonne connaissance à la fois de l'oeuvre de l'écrivain mais aussi de sa biographie (clinique pourrait-on ajouter). Dans ce cadre, certains articles comme celui de Philmus qui nous montre, documents à l'appui, un PKD complètement paranoïaque qui dénonce pêle-mêle tout le staff de SFS comme étant des agents communistes et Lem comme entité composite formées de plusieurs personnes (authentique) prennent tout leur sens.
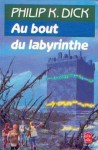
Marqué par la présence de diverses plumes francophones (Bozzetto, Jouanne, Fondanèche) ou d'articles relatifs à la scène SF française (qui ressort comme un peu atypique dans son engouement pour l'auteur), cet ouvrage offre aussi un nombre non négligeable de textes assez anciens (dont l'actualité et la pertinence sont donc à évaluer après lecture) ou de superbes exemples d'études jargonnantes (dont la première due à Suvin) avec forces diagrammes et usage intensif de mots de plus de quatre syllabes, ce qui est un exploit pour un texte en anglais. Finalement un livre assez dense (et écrit petit) parfois hermétique ou anecdotique mais dont le manque d'organisation (c'est un simple collage) le réserve aux exégètes.

Note GHOR : 1 étoiles (ou 2 pour les amateurs de l'auteur)
07:22 | 07:22 | Etudes mono-auteur | Etudes mono-auteur | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, dick, 2 étoiles | Tags : anglais, dick, 2 étoiles
17/06/2010
_Omegatropic : Non-fiction & fiction_
Omegatropic : Non-fiction & fiction : Stephen BAXTER : 2001 : BSFA (British Science Fiction Association) : ISBN-10 0-9540788-0-2 : 160 pages (y compris index et bibliographie) : coûtait 8 GBP pour un TP non illustré, existe aussi en HC (-1-0).
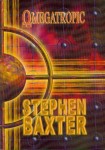
Ce petit recueil de textes fait partie d'un projet qui, utilisant la générosité de Baxter, avait pour but de récolter des fonds pour la BSFA, l'ancienne et principale organisation de fans britanniques à laquelle l'auteur à toujours été très lié. Surfant sur la notoriété réelle de Baxter dans son pays (et ailleurs) ce livre a rapidement été épuisé et montre que certains auteurs sont véritablement disponibles pour les amateurs et savent se souvenir de ceux qui les ont soutenus.

Cet ouvrage est une compilation d'une vingtaine des écrits de Baxter sur la SF. Il s'agit le plus souvent d'articles (ne dépassant pas la dizaine de pages) parus soit dans les périodiques de la BSFA (Vector, le principal titre de l'association mais aussi Focus), dans des revues spécialisées (Interzone, Foundation) ou des journaux professionnels (SFWA Bulletin). A noter que deux d'entre eux sont inédits. Thématiquement, les sujets abordés par Baxter sont vastes, allant de la façon de collaborer avec d'autres auteurs (Clarke ou Eric Brown) à la conquête spatiale (un des textes a été traduit dans Yellow Submarine) en passant par une évocation des oeuvres de SF se déroulant sur Titan ou sa façon d'écrire certains romans. En guise de bonus, ce recueil de non-fiction est agrémenté de deux textes de fiction, les courtes nouvelles On the side of the hill et Omegatropic qui donne son titre au livre. A la fin et après quelques pages de notes, on trouve deux index: un pour les noms propres et un pour les oeuvres de Baxter citées.

On passera tout d'abord rapidement sur les textes de fiction dont la non reprise dans les divers recueils de Baxter s'explique aisément au vu de leur qualité assez moyenne (pour être gentil). Nettement plus intéressant sont les articles et essais, même si la présence de trois notices nécrologiques (très courtes) fait un peu remplissage à moindre coût. On y retrouve l'habitude de l'auteur de faire pas mal de recherches avant d'écrire un livre, en particulier en ce qui concerne les traitements précédents du même thème au sein du genre, le fruit de ce travail qui nous est livré est toujours une occasion de découvrir des pans de l'histoire de la SF parfois peu connus.
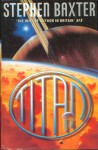
Au final un bon petit recueil plutôt agréable à lire même si sa construction entraîne logiquement un certain manque d'homogénéité vu les provenances et les objectifs parfois très différents de ses composantes. A ce titre, l'inclusion de fictions n'est d'ailleurs (AMHA) pas une réussite comme souvent en pareil cas (cf. The silence of the Langford chez NESFA qui est sur le même principe). Un ouvrage à posséder pour les nombreux amateurs de Baxter qui n'ont pas accès aux sources primaires.

Note GHOR : 2 étoiles
07:51 | 07:51 | Ouvrages de référence divers | Ouvrages de référence divers | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles, baxter | Tags : anglais, 2 étoiles, baxter


